Nietzsche, la souffrance et la maladie
Le site Santé Nature Innovation publie un article peu commun et pas facile à entendre par les temps qui courent. Mais cet article a interpellé notre rédaction qui a souhaité le relayer car il apporte peut-être certaines clés qui aideront nos lecteurs et lectrices à mieux comprendre notre monde moderne et progressiste. En réalité archaïque et décadent.
Bonne lecture et bonnes réflexions !
Nietzsche, la souffrance et la maladie
Publié le 16 juin 2020 dans Santé Nature Innovation

À l’âge de 4 ans, le jeune Friedrich Nietzsche perd son père, qu’il adorait.
Peu après survient la mort de son petit frère, Joseph.
Étudiant, il attrape la syphilis, une maladie infectieuse mortelle et très douloureuse.
Il passera le reste de sa vie accablé de nausées, de terribles maux de tête, de vomissements. Il restera parfois des journées entières dans une cécité complète. Il est obligé d’abandonner la carrière universitaire brillante qui l’attendait, et se réfugie dans une chambre modeste qu’il loue à un fermier au plus profond de la Suisse, seul endroit où sa santé fragile lui permet de survivre.
En hiver 1880, il tombe dans le « trou noir de son existence ». Il est au fond de l’abîme, au bord du suicide. Il rencontre une jeune Russe, Lou Salomé, et semble trouver enfin le bonheur. Mais l’aventure tourne au fiasco. Elle laisse Nietzsche profondément blessé, en 1883 :
« Je ne comprends plus du tout à quoi bon vivre, ne fût-ce que six mois de plus. Tout est ennuyeux, douloureux, dégoûtant ! », écrit-il.
Il n’eut que des déceptions avec les femmes, qui étaient il est vrai effrayées par son énorme moustache. « Grâce à ta femme, tu es cent fois plus heureux que moi », écrit-il à un ami.
Mais la syphilis, qui attaque le cerveau, gagne du terrain. Il perd la raison. Il est interné en hôpital psychiatrique puis meurt dans une misère noire.
Ses livres ne connaissent, durant sa vie, aucun succès, tant il est en décalage avec ses contemporains. Nietzsche vit dans une grande pauvreté, presque totalement incompris.
Nietzsche avait l’expérience de la souffrance, et voici ce qu’il recommandait de faire
Nous avons tous des zones sombres dans notre vie. Nous avons tous des difficultés qui paraissent insurmontables. Nous connaissons tous des échecs.
La plupart des philosophes ont essayé de nous aider à réduire nos souffrances. Ils nous ont donné des conseils pour nous consoler, et nous aider à nous débarrasser de nos douleurs.
Friedrich Nietzsche ne voyait pas les choses ainsi.
Il pensait que toutes les sortes de souffrances et d’échecs sont en réalité la clé vers le bonheur, et devraient donc être accueillies avec joie.
Pour lui, il ne peut y avoir de joie que dans le fait de surmonter des défis
Plus grands sont les défis, plus grande est la joie
… comme l’alpiniste recherche des montagnes plus hautes et plus difficiles à vaincre. C’est du haut de ces montagnes que l’on peut contempler les vues les plus belles, respirer l’air le plus pur. Et les parois les plus vertigineuses sont aussi celles qui ont la plus fascinante beauté.
“À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire”.
À l’inverse de tous les philosophes, Nietzsche pensait que c’était un avantage que d’avoir de graves déconvenues dans sa vie ! Il écrivait : « À tous ceux à qui je porte intérêt, je souhaite la souffrance, l’abandon, la maladie, les mauvais traitements, le déshonneur ; je souhaite que ne leur soient épargnés ni le profond mépris de soi, ni le martyr de la méfiance envers soi ; je n’ai point pitié d’eux, car je leur souhaite la seule chose qui puisse montrer aujourd’hui si un homme a de la valeur ou non : de tenir bon… »
Pour atteindre quoi que ce soit de valable, estimait Nietzsche, il faut faire des efforts gigantesques.
Nietzsche avait une vie routinière. Il se levait à 5 heures du matin, écrivait jusqu’à midi, puis allait marcher sur les immenses montagnes qui entouraient son village. De sa fenêtre, il pouvait contempler de magnifiques paysages qui parlaient à son âme. « Ne venez surtout pas me parler de dons naturels, de talents innés ! On peut citer dans tous les domaines de grands hommes qui étaient peu doués. Mais la grandeur leur est venue, ils se sont faits “génie” (comme on dit) », écrivait-il.
Et ils l’ont fait en surmontant les difficultés.
« Ce n’est pas par le génie, c’est par la souffrance, par elle seule, qu’on cesse d’être une marionnette », écrira après lui le philosophe nietzschéen Emil Cioran.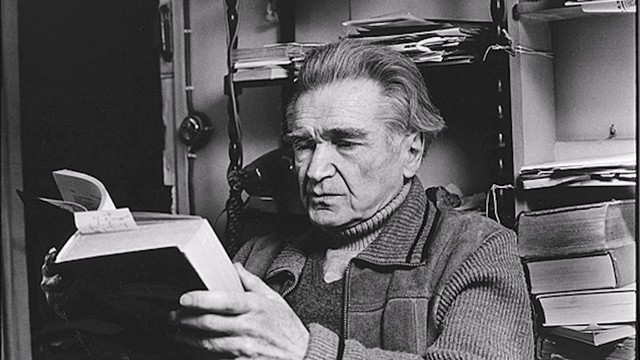
La difficulté est la norme
Nous éprouvons de la douleur à cause de la différence que nous constatons entre la personne que nous sommes, et celle que nous pourrions être.
Mais évidemment, souffrir ne suffit pas. Sinon, nous serions tous des génies ! Le défi, c’est de bien réagir à la souffrance.
Nietzsche pensait que nous devions considérer nos problèmes comme un jardinier regarde ses plantes. Le jardinier transforme des racines, des oignons, des tubercules, qui paraissent très laides, en de jolies plantes portant des fleurs et des fruits.
Dans nos vies, il s’agit de prendre des choses qui paraissent « moches » et essayer d’en sortir quelque chose de beau.
L’envie peut nous conduire à nuire à notre voisin, mais aussi à une émulation nous conduisant à donner le meilleur de nous-même. L’anxiété peut nous paralyser, mais aussi nous conduire à une analyse précise de ce qui ne va pas dans notre vie, et ainsi à la sérénité. Les critiques sont douloureuses mais elles nous poussent, en général, à adapter notre conduite.
Concernant la maladie elle-même, Nietzsche a écrit ceci : « Quant à la longue maladie qui me mine, ne lui dois-je pas infiniment plus qu’à ma bonne santé ? Je lui dois une santé supérieure, que fortifie tout ce qui ne tue pas ! Je lui dois ma philosophie. Seule la grande douleur affranchit tout à fait l’esprit. »
Mais bien entendu, les choses se passent en plusieurs temps : la “joie”, le “sens” de la maladie ne surviennent pas au moment où vous êtes en train de souffrir. Cela n’apparaît que lentement, et après coup, lorsque la vie offre une forme de répit. C’est alors, seulement, qu’on peut se retourner et voir le côté positif de l’épreuve.
« D’abord il y a la crucifixion ; ensuite seulement vient la résurrection », me disait un ami. Mais au moment où l’on est cloué sur la croix, ce n’est jamais drôle, évidemment… Ce qui me fait penser que, au fond, ces réflexions de Nietzsche ne peuvent être comprises que par les personnes d’un certain âge, qui ont déjà vécu, ont eu le temps de cicatriser leurs épreuves, et de prendre du recul.
Tout le monde n’a pas cette chance, et Nietzsche qui est mort à 56 ans, un âge respectable pour l’époque, aurait sans doute pu insister un peu plus sur ce point…
À votre santé !
Jean-Marc Dupuis
[source : Santé Nature Innovation]




