
Passer d’une économie extractive à une économie générative
Alain Bezançon, animateur du site Prémices du Nouveau Monde, nous a fait suivre l’article publié par Michel Bauwens dans Michel’s Substack : Fourth Generation Civilization.
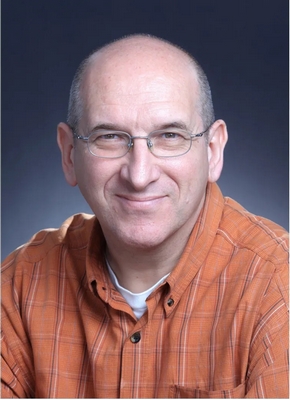
Michel Bauwens
Cet article nous a vivement interpellés car il s’insère parfaitement dans la prise de conscience de l’émergence d’un nouveau monde dont les prémices se dévoilent chaque jour un peu plus.
Ici c’est un économiste qui nous éclaire, après un physicien(1) avec sa perception scientifique du temps. Des expertises très différentes — économie, physique — nous conduisent à la même perception d’un monde qui touche à sa fin.

Au contraire ! Tous nous invitent à nous préparer à franchir le gué(2) vers le Nouveau Monde qui se dessine.
Nous devons passer d’une économie capitaliste « marchande » à une économie « contributive » basée sur le Bien commun
Je republie un texte que j’ai co-écrit avec Vasilis Niaros. Je trouve que ce texte n’a pas du tout vieilli, au contraire. J’estime que sa « valeur d’usage », en termes de nécessité d’une méta-transition, s’est bonifiée. Dans ce texte nous réfléchissons à la nature de la création de valeur, à la manière dont la valeur basée sur les biens communs diffère de la valeur marchande et à la manière dont nous pouvons passer d’un régime de création de valeur à un autre.
Ce texte est plus long que d’habitude, mais il aborde une question cruciale, et j’espère que vous prendrez le temps de le lire. La seule mise en garde est que les exemples que nous citions et décrivions auront évolué par rapport à la situation actuelle. Pour cette raison, j’envisage une mise à jour de cet article dans un prochain épisode.
La question qu’il faut se poser est bien :
Pourrons nous imaginer un mécanisme capable de mesurer la création de valeur qui prenne en compte de manière transparente toutes les contributions, directes et indirectes, qui créent et maintiennent le bien-être de l’humanité, ainsi que de son environnement naturel, condition de sa survie ?
Voici une version légèrement modifiée de notre texte original :
Le Bien commun est confronté à d’énormes questions concernant l’évolution de la création de valeur. Parmi les questions importantes auxquelles nous pouvons penser, citons les suivantes :
• Qu’est-ce que la création de valeur, en particulier dans le contexte de l’allocation des ressources dans les sociétés humaines, et peut-être plus spécifiquement encore, dans des sociétés plus « numérisées », « en réseau » où les connaissances partagées émergentes jouent un rôle de plus en plus important
• Que devrait être la création de valeur dans un monde marqué par des contraintes écologiques et de ressources qui s’exercent désormais à l’échelle mondiale ? et par suite,
• Pouvons-nous imaginer un système de valeurs qui récompense les activités et les échanges génératifs plutôt qu’extracteurs ?
• Dans un monde de diversité sociale, culturelle et institutionnelle, un nouveau « système de valeurs » pourra-t-il un jour intégrer les multiples valeurs non reconnues par le capitalisme, comme l’économie des soins et le travail domestique ?
Le livre de David Graeber, Towards an Anthropological Theory of Value, est une étude historique et anthropologique approfondie des façons de traiter la création de valeur, passant en revue la recherche et les approches anthropologiques, et témoigne en soi de la grande variété de pratiques et d’explications liées à la valeur économique. La principale thèse sous-jacente, si j’ai bien compris, est que la valeur est liée au fait de « faire société » et que nous avons besoin de mécanismes d’analyse de la création de valeur qui nous permettent de diriger notre attention et notre énergie vers ce que nous valorisons communément. La création de valeur naît à travers les pratiques sociales. Cela contraste paradoxalement avec le régime de valeurs capitaliste, qui semble ouvrir des voies dont personne dans la société, ou peut-être seulement une poignée de personnes, ne veut vraiment.
Il n’existe bien sûr aucun consensus sur ce qu’est la valeur et sur ce dont elle dérive, ni d’un point de vue historique, ni parmi les analystes et commentateurs du capitalisme contemporain. Ce à quoi les individus et les sociétés humaines sont prêts à consacrer leur attention et leur énergie, ainsi que les « règles du jeu », selon lesquelles les ressources sont allouées, varient selon les cultures, les différentes régions, les groupes idéologiques au sein d’une société et les différentes époques historiques.
Le débat fait donc rage sur la question de savoir si ce qui détermine la création de valeur
• se situe dans la sphère objective (reflétant une quantité de travail, d’énergie, de capital, de ressources…), comme le prétend la théorie de la valeur travail, ou ceux qui soutiennent que la valeur (et l’argent) devrait désormais être liée à la biomasse ou aux dépenses énergétiques
• ou bien elle se situe dans la sphère subjective (l’école marginaliste, l’économie autrichienne et son influence sur l’économie néoclassique dominante), que ce soit comme une simple corrélation de désirs individuels, ou comme une décision collective consciente et un contrat social (de nombreux réformateurs monétaires et par exemple les adeptes de La Théorie monétaire moderne adhéreraient à ce point de vue).
Il y a certainement un regain d’intérêt pour Marx et pour la théorie de la valeur travail, même si la littérature générale actuelle sur le marxisme est encore très pauvre en ce qui concerne la façon dont les Technologie de l’information et des communications et la numérisation affecteraient sa compréhension.
Une exception récente est le travail de Christian Fuchs. Une caractéristique commune de ces approches est l’affirmation selon laquelle, malgré les changements technologiques, le capitalisme lui-même est intact et que, par conséquent, les outils analytiques de Marx et de la théorie de la valeur travail restent essentiels. Fuchs a également publié un certain nombre d’ouvrages examinant comment la numérisation, l’émergence des médias sociaux et de la production par ses semblables et ses dérivés changent le capitalisme. Dans le cadre de cette tradition, Fuchs souligne que le « travail d’audience » des utilisateurs des médias sociaux est un « travail productif », et que Facebook et d’autres plateformes sont des plateformes capitalistes qui extraient de la plus-value du travail. Cela signifie également que les utilisateurs des réseaux sociaux sont considérés comme faisant partie de la lutte des classes au sein du capitalisme.
Il existe un deuxième courant, toujours à l’intérieur de la théorie de la valeur travail, représenté par des auteurs comme Jakob Rigi ou Olivier Fraysse, qui soulignent que la production de valeur d’usage ne crée pas directement de plus-value, et que les plateformes de réseaux sociaux ne font que percevoir des loyers. Facebook ne vend pas ce que nous produisons sur les réseaux sociaux, qui consiste à partager une « valeur d’usage » avec nos semblables. Ce que ces plateformes vendent sont des dérivés de notre partage, c’est-à-dire des données sur nos goûts et nos intérêts, essentiellement aux annonceurs. Elles n’agissent pas dans la production de valeur, mais dans la sphère de la réalisation ou de la circulation de la valeur, c’est-à-dire en aidant à vendre ce que produit le capitalisme, et en opérant comme les médias le faisaient avant Internet, à travers un travail d’audience qui assure la présence de l’attention.
Le troisième courant, toujours lié au marxisme, est la tradition post-autonomiste, dérivée des mouvements sociaux autonomistes italiens des années 70, avec des auteurs comme Michael Hardt et Toni Negri, et les analystes de l’école franco-italienne du capitalisme cognitif, Yann-Moulier Boutang, Andrea Fumagalli, Christian Marazzo ou encore Adam Arvidsson avancent globalement le même argument. Ces analystes soutiennent que la théorie de la valeur travail n’est plus le principal moteur du capitalisme cognitif et que la productivité du travail cognitif ne peut être comparée au temps de travail socialement nécessaire. La création de valeur symbolique, créative, esthétique et cognitive est hautement contextualisée et indépendante de la dépense de temps. Ils soutiennent également que la production de valeur s’est étendue à l’ensemble de la société, à ce qu’ils appellent « l’usine sociale ». Le travail est devenu « biopolitique » parce que le travail et la vie ont fusionné et sont devenus indiscernables. Maintenant que la production de valeur a lieu dans « l’usine sociale », la valeur est extraite de la totalité de la vie, dans une sorte de capitalisme bio-cognitif. La valeur produite par la société dans son ensemble est ce que Hardt et Negri appellent le Bien commun, et la valeur de ce Bien commun est extraite et « traduite » de « l’extérieur » du processus de production conventionnel – essentiellement à travers le secteur financier, de manière à créer et à renforcer l’inéquité de notre système économique.
Il existe bien entendu également des différences majeures entre l’approche fondamentale de ces auteurs. L’école négrienne est clairement une école anticapitaliste et estime que des rébellions et des révolutions locales et mondiales de la « multitude » sont nécessaires pour briser l’emprise de la finance sur le Bien commun. La préoccupation d’Adam Arvidsson dans The Ethical Economy est de rendre les nouveaux types de valeur (indépendants du temps de travail) mesurables et reconnaissables dans l’économie actuelle, afin que cette nouvelle valeur puisse avoir sa part légitime du gâteau distributif.
Ce sur quoi tous ces auteurs s’accordent cependant, c’est qu’il existe une « crise de la valeur », c’est-à-dire que l’ancien régime de valeurs ne reconnaît pas et ne récompense pas de manière adéquate la nouvelle valeur créée.
Le diagnostic est que nous sommes en transition vers une économie avec un nombre toujours croissant d’écosystèmes collaboratifs, où la valeur commune est produite par de nombreuses contributions, qui le plus souvent ne sont pas mesurées ou enregistrées, mais où cette valeur est ensuite réalisée ou capturée à travers nos systèmes financiers. La valeur est de plus en plus créée grâce aux contributions du plus grand nombre, mais réalisée au profit de quelques-uns. Cependant, la préoccupation concernant ce déséquilibre peut rester entièrement dans la sphère de la marchandisation. Dans ce cas, nous remplacerions simplement le travail marchandisé par des cotisations marchandisées.
Nous adoptons une position différente. Plutôt que de discuter de ce que la nouvelle valeur signifie pour le capitalisme, nous nous interrogeons sur ce que représente cette nouvelle valeur pour un changement vers des pratiques post-capitalistes ? Et si le Bien commun représente en réalité une nouvelle économie qui naît au sein de l’ancienne ?
Cela change la perspective car cela réoriente la discussion autour des « semblables producteurs » de Biens communs. Si l’on adopte cette perspective (nous anticipons les parties ultérieures de cet analyse), trois voies s’ouvriraient à nous :
• La première piste serait de réfléchir à une « cooptation inversée » de la valeur de « l’ancien » système vers le nouveau. L’économie émergente centrée sur le Bien commun qui crée de la valeur dans et à travers la collectivité, peut-elle utiliser le capital du système capitaliste ou étatique et intégrer le capital à la nouvelle logique ? Cette prémisse part de la position réaliste selon laquelle le nouveau système n’a pas (encore ?) le pouvoir de changer la logique globale du système actuel, mais il peut se tailler des niches relativement protégées en son sein.
• La deuxième piste va encore plus loin, dans les limites de l’économie des biens communs déjà existante : des flux de valeur plus larges peuvent-ils être reconnus et devenir la base d’une nouvelle distribution de valeur qui reconnaît les biens communs et ses types distincts de création de valeur ?
• La troisième piste sera la plus difficile : si les communautés de biens communs réussissent à la fois dans la cooptation inversée et dans de nouvelles stratégies de distribution de valeur au sein des limites de leurs communautés, comment cela deviendra-t-il la base d’un changement de système plus large, qui affecterait la domination même du capitaliste ? marché et son régime de valeur ?
[ … ]
Avant de documenter précisément ces pratiques, nous devons approfondir notre compréhension de la crise des valeurs.
Analyser la crise des valeurs
Une série d’ouvrages récents ont utilisé des dérivations de la théorie de la valeur travail pour mettre en évidence une « crise de la valeur » :
Le livre d’Adam Arvidsson, The Ethical Economy, dans une thèse précédemment exposée dans un essai conjoint de Michel Bauwens, est l’un des nombreux traités soulignant que les pratiques capitalistes contemporaines de valeur ne sont plus capables de déterminer ce qu’est la valeur. La valeur est aujourd’hui plus que jamais essentiellement co-créée dans la sphère civique et sociale, et elle ne peut se limiter à la valeur économique telle que reconnue par le système du capital. La valeur matérielle des produits et des services, et des entreprises qui les vendent, ne représente qu’une fraction de la valeur totale générée d’une manière ou d’une autre par les forces économiques, comme en témoigne la valeur des actions bénévaoles, qui dépasse largement la valeur des ressources matérielles.
Le marché boursier n’est plus un moyen adéquat pour reconnaître et évaluer cette valeur sociale. Il faudra peut-être développer de nouvelles mesures de valeur, mais aussi reconnaître que de nombreuses activités humaines sont au-delà de la « valeur » et ne peuvent pas, ou ne devraient pas, être mesurées. Bon nombre des nouvelles mesures de valeur actuellement développées et expérimentées seront des « mesures actuelles » post-monétaires, comme l’appelle Arthur Brock du Meta Currency Project – des systèmes qui permettent aux communautés de voir le flux et d’y réagir.
Notre propre interprétation centrée sur le Bien commun est que les sociétés humaines, grâce à la production entre semblables et aux modalités associées de création de valeur, sont désormais capables d’augmenter de manière exponentielle la production de valeur d’usage en dehors des entreprises et des marchés.
Cependant, parce qu’une valeur d’usage immatérielle abondante et reproduite numériquement est générée en dehors de la forme marchande, elle se déplace vers la périphérie de la production marchande et, par conséquent, des quantités toujours plus grandes de production de valeur d’usage ne sont plus reconnues par la monétisation. Cela crée une crise d’accumulation du capital (car il devient plus difficile pour le capital de découvrir des sources de rendement fiables), mais aussi une crise de moyens de subsistance précaires.
Il n’est pas difficile de voir que les réponses à cette énigme pourraient pencher vers des réponses capitalistes plus intensiveset le partage du Bien commun. L’une des solutions, préconisée par Jaron Lanier, consiste à monétiser et à marchandiser l’économie numérique grâce aux micro-paiements. Ceci est similaire aux efforts habituels visant à valoriser les « services de la nature » à travers des marchés artificiels, comme pour les droits de pollution, et nous pouvons voir des efforts similaires préconisés dans l’économie de la santé. Dans ces visions, les marchés et le capitalisme sont considérés comme l’horizon incontournable des sociétés et de leurs économies, pour lequel une plus grande marchandisation est la réponse naturelle et incontournable. Les acteurs capitalistes assimilent les nouvelles chaînes de valeur selon des termes anciens et familiers. Bien sûr, il existe de nombreuses autres propositions de valorisation qui ne procèdent pas d’un désir de marchandisation, mais du désir justifié de créer un flux de ressources et de revenus vers les biens communs numériques, l’économie des soins et les personnes impliquées dans la gestion et la protection des ressources naturelles. Une question clé ici est la suivante : les efforts de valorisation peuvent-ils conduire à une autre réalité que la marchandisation ?
Jeremy Rifkin, dans son livre The Zero-Marginal Cost Society, soutient que la tendance à la démarchandisation observée dans les domaines immatériels (logiciels, réseaux sociaux) s’étend désormais à la production « matérielle ». L’énergie renouvelable distribuée crée, une fois l’investissement initial réalisé, un flux d’énergie abondant qui détruit sa valeur monétaire. Les nouvelles techniques de fabrication telles que l’impression 3D créent un effet similaire pour de nombreux biens matériels. Rifkin prédit donc une économie future dans laquelle les biens communs collaboratifs démonétisés sont au cœur de la production et les fonctions de marché opèrent à la périphérie.
Paul Mason, dans son livre Post-Capitalism, utilise la théorie de la valeur travail pour avancer un argument similaire. Selon lui, les logiciels et le design, une fois produits via des espaces communs ouverts et collaboratifs pouvant être abondamment reproduits, devraient être considérés comme des « machines virtuelles ». Cela signifie qu’une fois que la main d’œuvre est utilisée pour produire un nouveau logiciel, très peu de nouvelle main d’œuvre est nécessaire pour le reproduire et, par conséquent, l’apport de main d’œuvre est minimisé. Cela rend les éditeurs de logiciels qui opèrent avec la main-d’œuvre moyenne socialement nécessaire, hyper-compétitives par rapport à leurs concurrents, mais parce qu’elles sont capables d’éliminer le coût de la main-d’œuvre dans la production. Ils réduisent également la réserve globale de profit pour des secteurs entiers de l’économie, créant une crise d’accumulation de capital à travers une baisse des taux de profit.
Le livre le plus influent de la dernière décennie est peut-être Race Against The Machine, d’Erik Brynjolfsson et Andrew MacAfee, qui souligne le danger d’une automatisation accrue. L’automatisation s’est désormais déplacée vers le travail du savoir et menace de détruire des millions d’emplois. À mesure que les produits deviennent de plus en plus abondants et moins chers, affirment-ils, avec de moins en moins de travail humain nécessaire pour les produire, il y aura de moins en moins d’humains comme consommateurs, et le capitalisme tel que nous le connaissons cessera de fonctionner. Le livre a conduit à une vaste réévaluation des pratiques de valeur et à des appels à l’instauration d’un revenu de base, y compris de la part des dirigeants de la Silicon Valley, qui sont plus conscients que d’autres du potentiel de cette vague d’automatisation à perturber la stabilité de l’économie capitaliste.
Ainsi, au moins parmi les auteurs examinés ici, il semble exister un consensus croissant sur le fait que nous traversons une « crise des valeurs » et qu’un nouveau régime de valeurs doit être inventé.
Les auteurs féministes ont souligné l’autre aspect de cette crise des valeurs, qui est une caractéristique constante du capitalisme et même une des conditions de son existence, comme le soutient Silvia Federici dans son magistral Caliban et la sorcière. Cet argument est bien sûr que le capitalisme ne peut exister sans externaliser les coûts et sans s’approprier des ressources « gratuites » (telles que la reproduction sociale qui s’effectue à travers les familles et la production de soins).
Ne pas reconnaître et ne pas valoriser le travail familial et domestique, un investissement d’amour si crucial à la survie humaine, est l’un des processus majeurs qui conforte l’injustice du système actuel.
Il convient de noter que le capitalisme rend invisible l’économie des biens communs de la même manière qu’il ignore la valeur du travail familial et domestique. La crise de la valeur numérique a des racines similaires : l’augmentation du travail gratuit reste méconnue. Le capitalisme ne se contente pas ici d’ignorer les externalités environnementales et sociales négatives, il profite des externalités sociales positives générées par le travail de soins, les biens communs et les communautés numériques. C’est là la principale réussite du nouveau « capitalisme netarchique »(3) : il a appris à profiter directement des externalités sociales positives de la production entre semblables basée sur le Bien commun, tout comme il a toujours profité du travail familial et domestique non reconnu. Une idée intéressante ici est que certaines des solutions inventées par les communautés de production par les semblables pourraient également intéresser l’économie de la santé, et peut-être vice versa.
Je proposerais que les concepts d’économie de la santé et celui d’économie du Biens commun convergent dans la même direction générale. Comme l’a souligné Peter Linebaugh, les biens communs nécessitent une activité de mise en commun, qui n’est rien d’autre que la prise en charge d’une ressource commune ou d’un objet social commun. Les soignants consacrent souvent énergie et attention à des biens communs non reconnus, tels que les biens communs liés au maintien de la famille.
Les auteurs de l’économie de la santé, comme Ina Praetorius, appellent à un retour de « l’économie » à sa fonction originelle de subvenir aux besoins humains et à reconnaître tous ceux qui contribuent au bien-être général. L’implication vers une économie des biens communs, vers une économie centrée sur le Bien commun, notamment la santé où les soignants devraient pouvoir choisir librement domaine d’activité, doit être reconnue et valorisée afin qu’ils puissent mener une vie digne. La bienveillance et le partage placent l’affectivité au cœur de la production.
Peut-être tout aussi importante est la capacité d”« intégration de petits groupes à l’échelle globale », l’une des caractéristiques clés de la production de biens communs ramène certes à la dynamique communautaire de notre condition anthropologique originelle de chasseurs-cueilleurs, mais elle y ajoute la logique affective de la pérennité de l’espèce. Ce contexte d’une dynamique de petits groupes, ramène la santé au centre de la création de valeurs.
Ceci nous conduit à une question centrale peut-être encore plus importante de la crise des valeurs actuelle, car elle implique notre « capacité de survie », c’est-à-dire notre lien avec le monde naturel, dans lequel nous sommes intégrés et dont nous sommes une partie substantielle.Il semble clair que le régime de valeur actuel récompense les activités de production et de consommation « extractives ». Cela met de plus en plus en danger la « durabilité » de la planète, ou plutôt la capacité de la planète à maintenir le niveau actuel des activités humaines.
Cela souligne la nécessité d’un changement de régime de valeur, de « l’extraction » à la « génération » (et à la régénération).
Liant la valeur à son expression dans nos systèmes monétaires, l’écologiste John D. Liu suggère que : « Si nous disons que l’argent provient de la fonction écologique plutôt que de l’extraction, de la fabrication, de l’achat et de la vente, alors nous avons un système dans lequel tous les efforts humains visent à restaurer, protéger et préserver la fonction écologique. C’est ce dont nous avons besoin pour atténuer le changement climatique et nous y adapter, pour garantir la sécurité alimentaire et la survie des civilisations humaines. Notre système monétaire doit refléter la réalité. Nous pourrions avoir une croissance, non pas grâce à des choses, mais à partir de davantage de fonctionnalités. Si nous faisons cela et que nous accordons plus de valeur à cela qu’aux autres choses, nous survivrons. »(4)
Nous pouvons également appliquer ce principe à « l’extraction sociale » et le relier à la transition potentielle vers une économie du Bien et de la santés.
Comment passer d’une économie extractive à une économie générative en ce qui concerne les communautés humaines et leurs biens communs ?
En effet, la « crise des valeurs », telle que nous l’avons décrite ci-dessus, signifie que davantage de valeur est extraite des activités productives génériques et que moins de valeur en revient. Le format actuel du « capital netarchique » – dans lequel le capital ne produit plus de marchandises à vendre par le biais d’un travail marchandisé, mais « permet » la production de biens communs entre semblables et les « échanges » entre semblables afin d’en extraire une rente – est de la même manière « socialement » insoutenable.
En conclusion, il semblerait que les trois questions que nous avons évoquées, à savoir :
• la non-reconnaissance de la valeur des travailleurs du numérique et des utilisateurs des réseaux sociaux,
• la non-reconnaissance de la valeur des soignants,
• et la dégradation écologique continue de notre planète et de ses ressources,
sont toutes liées à la domination d’un système basé sur le pillage.
Par conséquent, le changement sous-jacent clé nécessaire est celui des modèles extractifs, des pratiques qui enrichissent les uns aux dépens des autres (communautés, ressources, nature), vers des modèles de valeurs génératives, des pratiques qui enrichissent les communautés, les ressources, etc. auxquelles ils sont appliqués. C’est ce que l’on pourrait appeler la migration de la valeur.
[ … ]
La question qu’il convient de se poser est donc celle-ci :
Pourrons nous imaginer un mécanisme capable de mesurer la création de valeur qui prenne en compte de manière transparente toutes les contributions, directes et indirectes, qui créent et maintiennent le bien-être de l’humanité, ainsi que de son environnement naturel, condition de sa survie ?
Michel Bauwens
[source] What do we mean when we say we are shifting from a capitalist “commodity” economy, to a commons-based “contributive” economy ?… and, how do we get there ? du 28 févr. 2024
Traduction Nice Provence Info
Lire dans nos colonnes : Philippe Guillemant nous dit pourquoi il croit au « Futur lumineux » du 24 février 2024
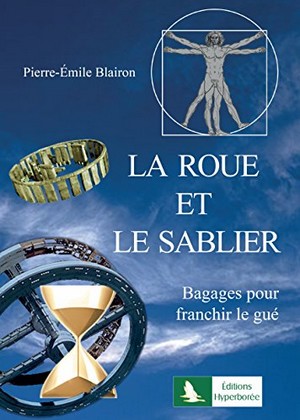
Pour Michel Bauwens : Les capitalistes netarchiques (Facebook, Google, Amazon, …) fonctionnent avec 100 % des revenus pour les propriétaires et 0 % pour les utilisateurs qui cocréent la valeur de la plateforme. C’est de l’hyper-exploitation ! Ce sont des modèles parasitaires : Uber n’investit pas dans le transport, ni Airbnb dans l’hôtellerie, ni Google dans les documents, ni YouTube dans la production médiatique.
NDLR : notre illustration à la une : mine de cobalt au Congo

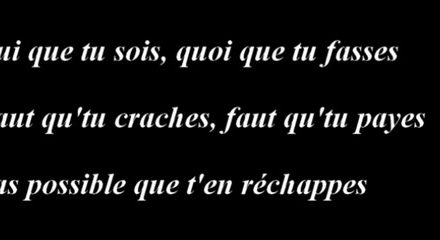

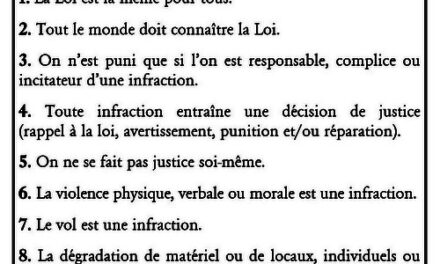

Aucun commentaire